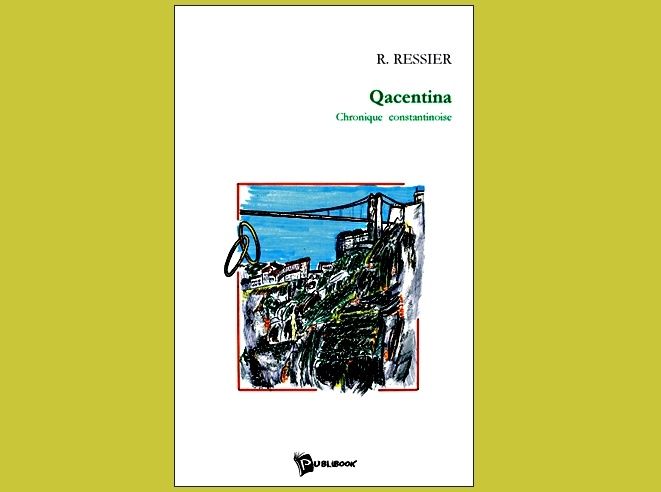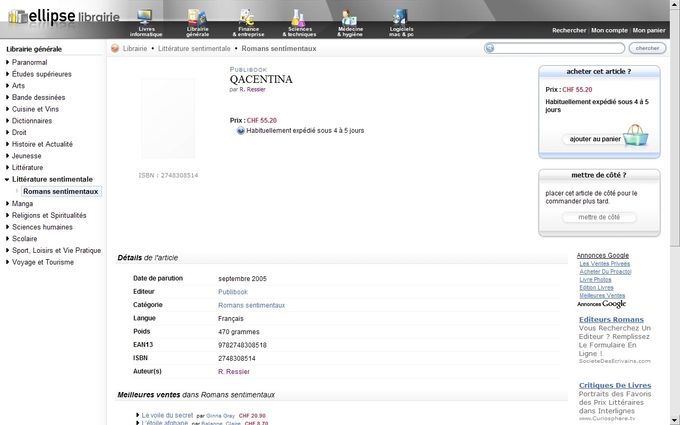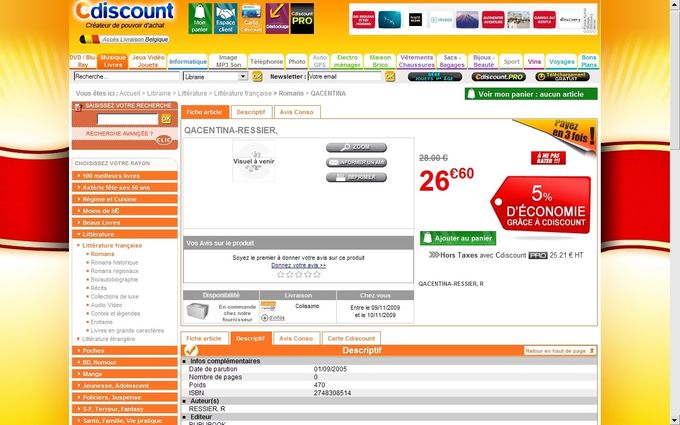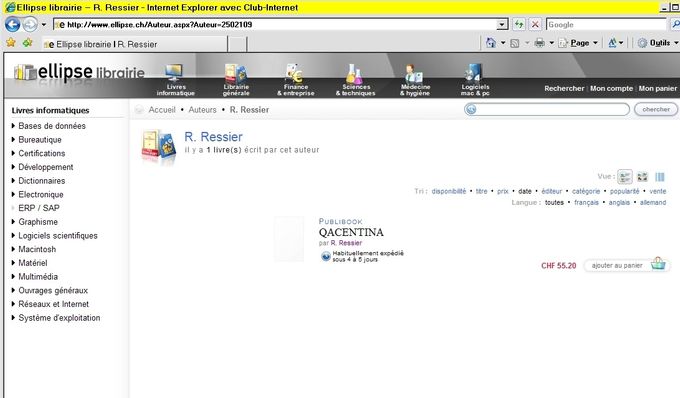Qacentina - Chronique constantinoise
(Ce livre a été publié sous le pseudonyme: R. Ressier)
PRESENTATION
Yvan Moreau a trente ans, il est ingénieur et il décide un jour de rompre avec son quotidien routinier pour partir en Algérie.
Sur le bateau qui l'emmène vers sa destination, Constantine, tout est déjà différent: les couleurs, les sensations... A son arrivée c'est tout un monde qu'il découvre, ainsi qu'une autre manière de vivre et les conflits qui existent encore entre les moeurs occidentales et orientales.
Mais la grande découverte de ce périple, ce sera aussi l'amour...
APPRECIATIONS du Jury du concours international PROMETHEE - ATELIER IMAGINAIRE
"Description réaliste, à la manière de Flaubert, d'une liaison, mais aussi d'un cadre social et des moeurs d'un pays, remarquable par la précision impressionniste des détails et la finesse de la psychologie."
"Style... qui épouse la réalité du paysage, des moeurs, des sentiments, des personnages."
"Transposition artistique d'une réalité vécue, souvent avec un sens aigu de l'image."
"Thèmes et idées sont originaux. L'auteur met en relief les conflits sentimentaux entre les personnages occidentaux... et les Algériens. Les différentes mentalités sont étudiées de façon précise... Le cadre est minutieusement analysé et dépeint, de façon très réaliste."
"... aventure sentimentale... qui se déroule dans un cadre que la photographie ne saurait mieux rendre pour qui ne connaît pas l'Algérie."
"La description, redisons-le, est captivante dans tous les domaines, physique, psychologique, moral."
PRESENTATION de l'EDITEUR
L'auteur nous entraîne ici dans une aventure initiatique où sens et sensations se découvrent d'un coup, dans un cadre magique, exotique, mystérieux.
Il dépeint avec un réalisme subtil le décor et les mentalités, soulignant minutieusement les moindres mouvements de l'atmosphère dans des descriptions envoûtantes.
Un roman tout en finesse...
AUTEUR
Professeur d'université durant un long séjour en Algérie au titre de la coopération culturelle, l'auteur a pu découvrir un pays très attachant, dans une remarquable complicité - non dénuée de conflits psychologiques - entre deux peuples que les aléas de l'Histoire ont rapprochés puis séparés...
CARACTERISTIQUES du livre
format: 22,5 x 14 cm
331 pages
13 chapitres
ACHAT
Ce livre QACENTINA est disponible, en version papier, sur commande:
chez l'éditeur
Editions Publibook
14, rue des Volontaires
75015
PARIS
(Tél:01 53 69 65 59 Fax:01 53 69 65 27)
dans les magasins FNAC et sur les sites internet suivants:
Ce livre peut également être téléchargé, à moitié prix, sur le site de l'éditeur
Extrait du chapitre 6 du livre "Qacentina - Chronique constantinoise"
Lynda venait d’avoir ses vingt et un ans qu’elle étrennait sur le campus de Constantine où elle s’était inscrite en tronc commun de biologie. Jeune fille sage et réservée, elle appréciait pourtant le dépaysement total procuré par la vie universitaire, en comparaison de la discipline et des contraintes qu’elle avait connues les années précédentes au lycée de Sétif. Venue au monde dans une mechta très pauvre des hauts plateaux, elle avait eu la chance de posséder des parents intelligents ayant compris que l’avenir d’un enfant résidait dans l’instruction. Et comme à l’école du douar, puis au lycée, la petite fille avait montré de bonnes aptitudes intellectuelles, elle avait poursuivi ses études jusqu’en classe de terminale. Le baccalauréat de sciences, bilingue, obtenu, Lynda avait opté pour la carrière de médecin. C’est ainsi qu’elle s’était inscrite en première année préparatoire commune aux filières de biologie.
A peu près chaque matin, vers huit heures moins le quart, elle quittait sa chambre de la cité universitaire Nahas Nabil, qu’elle partageait avec deux camarades physiciennes, et prenait le bus ou pratiquait l’auto-stop du côté de la mosquée, afin de monter au campus d’Aïn El Bey. Là-haut, elle suivait les cours, séances d’exercices et travaux de laboratoire correspondant à quatre modules de mathématiques, physique-chimie, biologie et sciences naturelles. Dans ses moments libres, elle travaillait ou lisait à la bibliothèque centrale. A midi, elle prenait son repas dans le vaste restaurant circulaire. Cette vie lui plaisait, par l’impression de prise en charge de soi-même que l’on y ressentait, dans le cadre d’un système relativement souple. Les horaires d’ouverture de la bibliothèque ainsi que ceux de la restauration étaient très larges, et l’on pouvait s’absenter d’un cours sans problème, à condition toutefois de ne pas répéter la chose trop souvent. En contrepartie, certains inconvénients étaient apparus, tels que la mauvaise qualité de la nourriture du self-service, l’ambiance bruyante de la cité ou la précarité des moyens de transport. Lynda n’aimait guère utiliser l’autobus, pourtant pratique puisqu’il prenait les étudiants dans la cour même de la cité, car il s’y trouvait fréquemment des garçons peu scrupuleux profitant de l’entassement général pour serrer les jeunes filles de trop près. Elle préférait encore les aléas de l’auto-stop qui, finalement, marchait fort bien car l’essentiel du flux des voitures des enseignants habitant le quartier du 20-Août devait passer le long de la cité universitaire, en face de la mosquée en construction.
Le mardi était sa journée la plus rude de la semaine : cours de huit à quatorze heures et séance de laboratoire de quinze à dix-sept heures, avec pour seul repos, deux interclasses d’un quart d’heure et la durée d’un repas mal réchauffé. Le système d’enseignement modulaire péchait par une trop grande disparité de choix des modules entraînant des chevauchements ou des emplois du temps déséquilibrés. Après avoir remis le compte-rendu des travaux pratiques qu’elle venait d’effectuer, Lynda sortit du laboratoire, cartable et blouse blanche sous le bras. Il lui tardait de retrouver sa chambre pour s’y reposer. Elle remonta le long du couloir courbe du bâtiment des sciences vers le hall d’entrée. A cet instant, son regard fut attiré, sans qu’elle sache pourquoi, vers un professeur qui sortait d’un amphithéâtre en même temps qu’un groupe d’étudiants peu pressés. Son bref coup d’oeil lui suffit pour juger, à quelque chose d’indéfinissable, de sa nationalité française ou belge, mais certainement pas roumaine, russe ou bulgare. Elle sortit la première de l’immeuble et s’engagea sur l’allée conduisant à l’esplanade centrale et à la tour administrative. Tout à coup, un sentiment curieux l’envahit : elle ressentit le poids d’un regard sur sa nuque. Elle comprit qu’on l’observait avec insistance mais n’osa pas se retourner et continua à marcher. Elle sut même de qui il s’agissait. Quand elle eut atteint le bord de la route intérieure menant à la sortie du campus, elle décida de lui faire de l’auto-stop. Il avait en effet gagné le parking adjacent, qu’il quitta bientôt, au volant d’une belle voiture qu’elle ne connaissait pas. Un discret signe de la main et elle se vit confortablement installée dans un fauteuil digne d’un salon. L’autoradio diffusait une jolie chanson de Nadia Benyoucef et ce détail l’aida à vaincre sa timidité. Elle lui demanda s’il comprenait l’arabe. Il sourit et répondit négativement en expliquant son désir de mieux connaître la musique algérienne et orientale. Elle se tourna légèrement vers lui et posa son regard sur les mains fines qui, avec douceur et précision, actionnaient les commandes.
- Votre voiture est un vrai bijou, est-ce une marque américaine ? fit-elle en scrutant la planche de bord.
L’intérêt que manifestait l’étudiante pour son véhicule étonna Moreau mais il s’empressa de répondre pour rétablir la vérité.
- Elle doit surtout convenir pour les autoroutes ou les grandes lignes droites du Sud, pensa-t-elle tout haut.
En guise de commentaire, et comme il approchait de l’épingle à cheveux la plus serrée de la route de l’université, il accéléra brutalement et franchit le virage les quatre pneus hurlant, dans un travers rendu audacieux par la proximité du ravin. Ne s’attendant nullement à un tel traitement, la jeune fille réprima un cri de frayeur qui se mua bien vite en un rire épanoui.
- Je crois que votre voiture est également valable en virage ! s’écria-t-elle.
La glace était brisée entre eux et ils s’échangèrent leurs prénoms respectifs. On arriva près de la grande mosquée et, à tout hasard, il l’invita à venir prendre un verre chez lui. Elle accepta. La CX passa donc en trombe devant la cité universitaire et poursuivit sa route vers le quartier de Bellevue.
Ils discutèrent un moment devant une “gazouz” fraîche. Il pouvait maintenant la regarder à loisir, alors que dans la voiture, quelques brefs coups d’oeil lui avaient seulement appris que Lynda portait des cheveux noirs assez longs, avait un visage fin, un petit menton et des yeux verts. Quand, dans l’allée du bâtiment des sciences, il avait remarqué sa silhouette moulée par un jean bleu et un pull noir ajustés, il l’avait trouvée attirante. Mais à présent, il était frappé par la profondeur étrange du regard de la jeune fille. Ce brin de mystère excitait sa curiosité. A ses questions, elle répondait d’une voix douce et avec un sourire évanescent qui lui évoquait la Joconde. Et c’était vrai qu’elle avait quelque chose du modèle de Léonard de Vinci. Il eut envie de lui faire part de sa comparaison mais se retint car, après tout, peut-être ne l’aurait-elle pas envisagé comme un compliment. Il se contenta d’un banal :
- Vous avez de beaux cheveux, suivi d’un audacieux :
-J’aimerais vous embrasser... le permettez-vous ?
Elle répliqua quelques mots en arabe :
- Asténa chouïa, habibi, qu’il ne comprit évidemment pas. Mais le rapide geste de la main qui accompagna ces paroles parut assez expressif pour qu’il n’insistât pas davantage.
Ils parlèrent encore de l’université et des études puis elle manifesta le désir de regagner la cité Nahas Nabil. Il voulut la reconduire en voiture mais elle refusa en le remerciant. Ils se serrèrent la main et se dirigèrent vers la porte. Juste avant de franchir le seuil, elle se retourna, posa un furtif baiser sur sa bouche du Français... et disparut aussitôt. Curieuse fille, pensa-t-il...
o-o-o-o-o
Depuis que la journée continue avait été adoptée à la SONATREL, Moreau occupait la plupart de ses fins d’après-midi soit à préparer son cours d’électronique, qui avait atteint son rythme de croisière, soit à rendre visite à Julie. Souvent, elle téléphonait pour l’inviter à dîner. Elle se sentait délaissée par son mari qui s’absentait de plus en plus fréquemment pour rejoindre sa maîtresse allemande. Elle en souffrait et sombrait quelquefois dans un état dépressif ou dans des crises de larmes. Elle se raccrochait à Moreau qui, par son calme, sa lucidité et sa gentillesse, lui procurait un regain de sérénité. Elle pouvait se confier entièrement à lui et en concevait beaucoup de reconnaissance.
Une semaine passa. En reprenant sa voiture, ce jour-là, sur le parking de l’université, Moreau découvrit un petit morceau de papier coincé dans la glissière d’une vitre latérale. Il le déplia et lut : “Je vous attendrai ici-même demain soir à dix-huit heures”, avec, en guise de signature, un L majuscule. Il ne voulut pas se l’avouer mais ce message lui mit de l’allégresse au coeur. Il dévala les lacets du chemin à toute allure et, arrivé au bas de la colline, au lieu de virer en direction de la ville, il tourna sur la gauche en prenant la route de l’aéroport. La douzaine de kilomètres l’en séparant furent avalés en six minutes, malgré les nombreux virages qui faisaient le régal du pilote. A chaque instant, il avait à dépasser des taxis en surcharge : un avion devait sans doute être en partance soit pour Alger soit pour Marseille, Lyon ou Paris. La route contournant la piste de l’aéroport d’Aïn El Bey, il put voir, en effet, devant l’aérogare, un Boeing d’Air France subissant les opérations de prévol. Deux minutes après, la Citroën arrivait au niveau d’un immense cimetière de voitures et de ferrailles diverses. Poursuivant sur sa lancée, elle traversa le village de Guettar El Aïch et, peu avant celui d’El Khroub, rejoignit la nationale ramenant à Constantine. Ce circuit d’environ trente kilomètres, il le connaissait par coeur car c’était là qu’il faisait ses essais de pilotage et de vitesse quand l’envie lui en prenait.
Durant toute la journée du lendemain, il pensa au rendez-vous. Enfin, vers dix-sept heures quarante-cinq, il quitta la villa et s’en fut à l’université. Personne sur le parking. Il rangea la voiture et attendit. Il était en avance de quelques minutes. Il mit en marche l’autoradio et patienta en compagnie de flûtes sahariennes aux accents mystiques. Le flash d’information débutait lorsqu’elle apparut.
Autant, lors de la première rencontre, Lynda avait une allure de simple petite collégienne, autant cette fois-ci, elle faisait jeune fille distinguée et presque grande dame. La couleur exclusive de sa tenue était le noir. Noir de la chevelure, noir du chemisier à longues manches, et noir des chaussures. Un brin de vent soulevait le pan antérieur de la jupe, fendue sur les côtés et noire elle aussi, obligeant la jeune fille à tenir d’une main le tissu voltigeur. La scène était charmante. Un discret parfum emplit l’habitacle lorsqu’elle monta en voiture.
o-o-o-o-o
Dans la pénombre de la pièce, il avait passé son bras autour de ses épaules et il l’embrassait tendrement. L’heure n’était plus à la conversation mais à l’intimité sensuelle silencieuse. Leurs lèvres se goûtaient, leurs corps se touchaient. Il appliqua sa main sur sa poitrine ronde puis s’enhardit et, partant des genoux, frôla la peau nue en s’insinuant sous la jupe facilement ouverte. Elle esquissa bien quelques tentatives pour remettre en place l’obstacle factice du tissu léger, mais la présence des fentes latérales du vêtement lui firent rapidement renoncer, et elle accepta toutes les caresses de son partenaire. Progressivement, boutons, agrafes et fermeture-éclair sautèrent, pour elle comme pour lui jusqu’à ce qu’elle ne fût plus vêtue que de ses boucles d’oreilles, d’une chaînette en or à son cou, d’un bracelet et de quelques bagues, et qu’il ne portât plus que sa montre. Les doigts très doux de la jeune fille flirtaient avec le corps de son amant mais sans oser atteindre l’endroit le plus sensible, que ses beaux yeux verts évitaient également. Le canapé devenant trop exigu, il la prit dans ses bras et l’enleva jusqu’à la chambre.
La semi-obscurité qui y régnait semblait propice aux tendres aveux. Délaissant un vouvoiement superflu, elle murmura :
- Yvan, je t’aime. Depuis une semaine, je n’ai cessé de penser à toi. J’avais si peur que tu ne viennes pas à mon rendez-vous... Tu es gentil !
Il ne sut trop que dire. Il n’aurait pas été sincère s’il avait confié qu’il l’aimait. En un laps de temps si court, seul un coup de foudre aurait pu permettre un tel engagement. Or ce n’était pas le cas.
- Ne dis pas de bêtises, Lynda ! Nous ne nous connaissons pratiquement pas, et sans doute te trompes-tu sur mon compte.
- Mais non, je t’assure, mon chéri. Ce que je ressens dépasse tout raisonnement conscient. Et elle se serra plus fort contre lui.
Il préféra orienter la conversation vers une autre voie :
- Parle-moi de ton père, Lynda. Je crois que tu l’estimes beaucoup.
- Oh oui, c’est un homme si bon et compréhensif. Quand je rentre pour le week-end à Béni Fouda, où je suis née, un intense bonheur me saisit à la seule pensée de le revoir, et lui également éprouve ce sentiment vis-à-vis de moi. Malheureusement, les transports par autocars entre Constantine et Sétif, puis entre cette ville et le douar de ma famille, sont si pénibles que, souvent, je suis obligée d’espacer mes visites de plusieurs semaines. Mon père a travaillé la terre toute sa vie durant, d’abord comme employé de colons pieds-noirs, avant la guerre de libération, ensuite comme khamès dans une vaste propriété appartenant à un riche Algérien, enfin, jusqu’à aujourd’hui, comme attributaire de la révolution agraire. Il continue la culture bien qu’il approche de la soixantaine et qu’il souffre des séquelles des tortures infligées par les parachutistes français.
- Etait-il militant du FLN ? questionna Moreau.
- Au début non. Il m’a souvent raconté les événements de cette période, où le peuple algérien prenait conscience, après l’impulsion de départ donnée par quelques isolés, de l’importance et de l’enjeu du combat contre l’occupant colonialiste. Les trois premières années de la guerre furent très difficiles pour les partisans de l’indépendance car la majorité des gens n’imaginaient pas que l’on puisse renverser la mainmise française, établie depuis si longtemps sur la terre algérienne, et avec des moyens aussi rudimentaires que l’étaient ceux des premiers combattants, les moudjahiddines. L’opinion générale avait donc une tonalité fataliste: les colons étaient là, ils y resteraient, et il fallait s’en accommoder. Mon père raisonnait ainsi. Il faut dire qu’il avait été conforté dans ce sentiment d’impuissance par les douloureux événements de mai 1945 auxquels il avait directement participé.
Lynda suspendit son récit, comme plongée dans ses pensées... Elle frissonna.
- Sais-tu, Yvan, ce qui s’est passé ici, le jour où, chez toi, en Europe, on fêtait la
victoire sur le nazisme ?
- Non, je ne vois pas, avoua-t-il, mais raconte-le moi. Je veux apprendre l’histoire de ton pays.
Il glissa un oreiller derrière la tête de son amie; elle lui prit la main.
- Le 8 mai 1945, on avait organisé, comme en France, des défilés et des manifestations pour célébrer la fin de l’Allemagne hitlérienne. De nombreux Algériens avaient combattu dans les rangs des armées alliées. Beaucoup avaient péri pour la sauvegarde d’un pays qui n’était pas le leur et qui, de surcroît, leur avait imposé la colonisation. Mais l’heure était à la joie. On fêtait les rescapés de retour des fronts d’Europe. Dans toutes les villes du Constantinois, des centaines de milliers de gens, Européens et Algériens mêlés, s’apprêtaient à défiler dans les rues. Pourtant une sourde inquiétude s’était emparée de certains administrateurs coloniaux. Une rumeur avait circulé les jours précédents : les nationalistes autochtones voulaient profiter de l’audience rassemblée par l’événement pour faire connaître à la population leurs thèses antifrançaises. Le préfet, prenant les devants, avait donc mobilisé les forces de police et l’armée au cas où le maintien de l’ordre aurait exigé leur intervention. Les défilés s’ébranlèrent dans le calme. Mais ensuite des drapeaux aux couleurs nationales apparurent dans la foule, et des milliers de voix s’élevèrent pour proclamer l’espoir d’une Algérie indépendante. C’est alors que la barbarie s’abattit sur les villes de Guelma, Sétif et Kherratta. L’armée et la police coloniales ouvrirent le feu sur les manifestants qui s’écroulèrent par rangs entiers sous les balles meurtrières. On ne saura sans doute jamais comment, pourquoi et sur quel ordre la fusillade commença. A Sétif, mon père marchait dans le groupe de tête. Blessé à l’épaule, il se jeta à terre et ne dut son salut qu’au fait que les corps inertes des premiers martyrs formèrent un rempart devant lui. Il m’a souvent décrit ces instants tragiques où il se vit mourir à chaque crépitement des rafales de mitraillettes. Profitant du tumulte effroyable qui suivit, il réussit par miracle à fuir le centre ville et à se réfugier chez des amis. Le lendemain, sa blessure soignée et pansée, il rejoignit le douar de Béni Fouda, faisant une bonne partie du trajet à pied, en rase campagne, dans l’angoisse de rencontrer une patrouille militaire qui l’aurait, à coup sûr, trouvé suspect ou, pire encore, de croiser un groupe d’Européens armés qui n’auraient pas hésité à le descendre sans sommation. Car après la journée sanglante du 8-Mai, la tuerie continua. Le cycle infernal des représailles s’installa dans toute la région, les Algériens vengeant leurs frères en massacrant des colons par familles entières, et les pieds-noirs abattant tout indigène leur tombant sous la main. Enfin, au bout de plusieurs jours, le calme revint sur les villes martyres. Un calme de mort, d’incompréhension, de haine inscrite dans les coeurs. Les événements avaient fait plusieurs dizaines de milliers de victimes algériennes.
Moreau resta un moment abasourdi par le récit qu’il venait d’entendre. Jamais auparavant il n’avait eu connaissance de telles horreurs perpétrées par des Français.
- A bien y réfléchir, je pense que ceux qui ont été les acteurs ou les témoins de ces crimes se taisent volontairement, aujourd’hui, trop heureux que, même officiellement, on ait jeté un voile pudique sur cette tuerie. Vois-tu, Lynda, il aura fallu que je vienne ici, sur place, pour apprendre l’existence d’un tel fait, à la fois atroce et fondamental pour la compréhension de l’histoire de la révolution algérienne. En France, personne n’ose en parler.
Lynda reprit sa narration :
- Mon père se remit de sa blessure. Mais le choc des scènes vécues avait induit dans son esprit l’idée du renoncement à toute velléité de résistance à l’Etat colonial. En cas d’opposition, on ne pouvait qu’être broyé par la puissance étrangère, pensait-il. Il continua donc à travailler à l’exploitation agricole de son patron. L’islam qu’il pratiquait sincèrement l’aidait à supporter sa condition que, par ailleurs, il trouvait relativement confortable sur le plan matériel, car le fermier français se montrait humain envers lui et sa famille.
Voilà pourquoi, lorsque la guerre de libération se déclencha, neuf ans plus tard, en novembre 1954, mon père, comme la majorité des gens, resta sceptique quant à sa réussite. L’administration coloniale tentait, de son côté, d’exploiter ce sentiment en démarquant toujours les rebelles, les fellagas, de l’ensemble des Algériens supposés aspirer plus à la paix qu’à l’affrontement. Malgré cela, peu à peu, l’idée nationaliste rallia des adeptes dont le nombre s’enfla suffisamment pour acculer les Français à commettre de grossières erreurs psychologiques, par exemple les représailles contre des civils innocents. D’indifférente ou, le plus souvent, d’opposée aux moudjahiddines, la population devint sympathisante. Dans les dernières années de la guerre, on vit des douars et des villages entiers faire corps face à l’occupant pour protéger des combattants blessés ou affamés cachés dans les maisons. Les soldats de l’ALN, l’Armée de Libération Nationale, étaient reçus en héros dans les mechtas où les femmes s’empressaient de les soigner, de les nourrir et de leur préparer des provisions pour les combats futurs qu’ils auraient à livrer dans les djebels. Il arrivait aussi, malheureusement, que l’armée française repère les points de ravitaillement des maquisards et alors la terreur fondait sur ces pauvres familles. Tir au canon pulvérisant les habitations faites de pierres et de boue séchée, bombes au napalm incendiant les récoltes ou bien largage de parachutistes aux exactions brutales.
Une fraîcheur nocturne accusée commençait à régner dans la chambre et Moreau recommanda à sa jeune compagne de couvrir ses épaules nues. Il l’attira à lui sous la couverture qu’il avait remontée. Lynda poursuivit son récit :
- Ce que je viens de te décrire s’est produit chez nous. Mon père en effet, après avoir compris que la lutte devenait efficace même face à une armée puissante, quitta sa réserve et son fatalisme. Il contacta, par un cousin déjà au maquis, le chef du secteur de Béni Fouda et fut aussitôt mis à l’épreuve. Le FLN testait ses nouvelles recrues en leur confiant quelques missions relativement anodines, puis les compromettait dans un acte grave, un sabotage par exemple, afin qu’elles ne puissent plus se retourner. Placé dans l’impossibilité, au cas où sa ferveur révolutionnaire aurait faibli, de revenir à la vie civile car recherché par la police française, le nouveau militant, n’ayant plus rien à perdre, devenait ainsi un excellent combattant. La première fois, on donna à mon père un pseudo message codé, avec pour consigne de le porter à un responsable du secteur de Sétif et de ne le détruire qu’en toute dernière extrémité. Naturellement, la feuille de papier n’avait aucune signification précise. La mission suivante présentait un degré de risque plus net. Il s’agissait d’estimer les dimensions et particularités des murs d’enceinte d’une caserne située au coeur de Sétif. Mon père s’acquitta parfaitement de cette tâche en arpentant, l’air détaché, la façade et les côtés de la bâtisse, et en comptant mentalement le nombre de pas accomplis. Cela lui permit de fournir un plan mentionnant toutes les ouvertures avec leurs caractéristiques. La troisième opération, celle qui conditionnait réellement son passage dans les rangs de l’ALN, consista en un sabotage de la voie ferrée Alger - Constantine. Il dut, seul, déboulonner les rails, au risque d’être vu, sur une distance suffisante pour permettre leur écartement à l’aide d’un pied-de-biche. Tout se déroula comme prévu et un convoi de matériel militaire devant ravitailler les régiments de l’Est se disloqua dans le ravin.
A partir de ce jour, ma mère n’eut plus que de rares nouvelles de mon père monté au maquis. Dans notre douar, plusieurs hommes suivirent cet exemple et disparurent dans la clandestinité. Ils devenaient des moudjahiddines, se cachant dans les forêts du djebel, dormant dans les grottes qu’ils connaissaient parfaitement depuis leur enfance, accrochant les patrouilles ennemies qu’ils désorganisaient par leur mobilité, se repliant à la faveur de la nuit, mais payant un lourd tribut à la cause nationale.
o-o-o-o-o
Moreau émergea du sommeil beaucoup plus tard dans la matinée. Se voyant seul dans la chambre, il pensa que Lynda devait être au salon. Il n’y trouva cependant que la photographie et le message le priant d’aller la chercher à midi à la sortie de la séance de physique. Il fit un brin de toilette tant bien que mal car l’eau avait été coupée, comme tous les jours, vers huit heures, et se rasa, l’esprit occupé par les mêmes soucis que ceux de la veille. Puis il avala un verre de lait et mit un peu d’ordre dans la salle de séjour. En remettant les coussins du canapé en place, il découvrit le fin soutien-gorge coincé à la base du dossier et encore imprégné d’un parfum ténu. Le sous-vêtement et la photo lui donnèrent l’idée de demander à Julie ses impressions sur cette jeune fille. Les dons de médiumnité de la Française serviraient peut-être à élaborer une solution. L’expérience était à tenter. Un coup de téléphone à la cité du 20-Août pour savoir si les Toulousains n’étaient pas déjà partis en week-end, et il se mit en chemin.
Julie et Laurent Gaillet avaient tous deux les traits du visage tirés comme s’ils n’avaient pas dormi.
- Nous avons passé la nuit à discuter de nos problèmes de couple, expliqua Gaillet d’un ton las.
- Etes-vous au moins parvenus à un terrain d’entente ? s’enquit leur ami.
- Je crois que l’on tourne en rond, fit Julie, l’air désabusé. Laurent ne voit toujours que son petit intérêt personnel.
- Et toi, tu vis sur des principes conjugaux d’une autre époque, répliqua Gaillet. Mais à quoi bon se quereller à nouveau ! Seul, peut-être, le temps nous permettra d’évoluer l’un et l’autre et, qui sait, de nous retrouver plus tard...
Et il sortit.
Moreau expliqua le but de sa visite :
- J’ai rencontré, il y a quelques jours, une étudiante à l’université. Elle semble s’attacher à moi et je voudrais savoir ce qu’il en est exactement. Comme tu possèdes certains dons et que tu excelles à deviner la psychologie des gens, je fais appel à toi.
Il déposa sur la table la photographie et la pièce de lingerie, ce qui fit sourire Julie.
- Comment as-tu fait pour le lui subtiliser sans qu’elle s’en étonne ?
- Mais non, c’est elle qui l’a tout simplement oublié chez moi !
- Ou, peut-être, qui l’a laissé volontairement !
- Je n’avais pas pensé à cela. Quoi qu’il en soit j’aimerais que tu me décrives ce que tu ressens au sujet de cette fille.
Julie plaça la photo d’identité en face d’elle, sur la table, et posa la main sur le soutien-gorge, sans le déplier. Elle demanda à son ami de patienter sans faire de bruit pendant qu’elle se concentrait, et lui indiqua quelques revues, s’il désirait lire. Elle se mit à fixer l’image, tout en se décontractant. Le silence n’était pas total car l’animation du quartier et des magasins proches, en ce jeudi matin, se percevait à travers les fenêtres fermées comme un bruit de fond continu, mais qui, semblait-il, n’altérait pas la concentration du médium.
Moreau s’empara de journaux qui traînaient sur un fauteuil et les feuilleta distraitement en commençant par les dernières pages. Ils dataient de trois mois et avaient été apportés de France. En effet, la presse étrangère n’était pratiquement pas distribuée en Algérie, et il fallait être de connivence avec les libraires pour espérer mettre la main sur “Le Nouvel Observateur”, “Le Point”, “Elle” ou “Marie-Claire”. Le quotidien “Le Monde” n’arrivait qu’au compte-gouttes car la censure ne l’épargnait guère. Seuls périodiques régulièrement présents dans les vitrines, les titres tels que “Algérie Actualité” ou “Révolution Africaine” se voyaient confier le rôle de porte-parole du gouvernement ou du parti FLN, tout comme “El Moudjahid”, dans ses deux versions arabe et française. De temps en temps, une revue traitant d’électronique ou d’automobiles faisait une apparition, alors que des piles d’exemplaires vieux de plusieurs années garnissaient des rayonnages à moitié vides.
Moreau parcourut un article de politique d’un hebdomadaire parisien puis, remontant vers les premières pages, tomba sur une rubrique d’échos et nouvelles de la mode féminine. Une photographie étonnante attira immédiatement son attention. Au-dessous, un court paragraphe mentionnait qu’aux Etats-Unis, et donc bientôt en Europe, les jeunes femmes, après avoir adopté la mode “top-less”, s’apprêtaient à suivre celle des... boucles de seins. Et l’illustration montrait une cover-girl arborant à ses mamelons des anneaux d’or identiques à des boucles d’oreilles. Le ou la journaliste concluait l’entrefilet en interrogeant : “Jusqu’où irons-nous dans le sadomasochisme ? Verrons-nous le retour des femmes à plateaux et à cou de girafe ?” Cette lecture le laissa pensif et, tout à coup, une idée “lumineuse” traversa son esprit. Il tenait la solution de son problème. Il lui suffirait d’exiger de Lynda qu’elle subisse le même traitement que le mannequin de la revue. Bien évidemment, elle ne pourrait qu’être indignée et choquée d’une demande aussi scabreuse, et déduirait que son amant d’un jour présentait de détestables penchants sadiques. Et, très certainement effrayée, elle le quitterait sans remords ni désespoir. Le hasard avait bien fait les choses... que de l’avoir poussé à consulter ce magazine ! Très satisfait de son raisonnement, il songea pourtant que le plus désagréable serait de le mettre en pratique, c’est-à-dire de se faire passer vis-à-vis de la jeune fille, pour un homme bizarre et anormal. Cela lui répugnait d’une manière extrême et il ne se connaissait, en outre, aucun talent de comédien. Mais n’était-ce pas le meilleur moyen d’éloigner Lynda sans drame ? Sa résolution était prise. Dès qu’il la verrait, en fait le jour même, il tenterait l’expérience.
Julie se releva de sa méditation et fit part de ses impressions :
- Globalement, je ressens cette fille comme une personne “bien”... Je veux dire qu’elle m’est a priori sympathique et tu sais, Yvan, que je décèle en général immédiatement les gens attirants et sérieux par rapport aux caractères troubles, retors ou mal intentionnés. Je la crois également assez intelligente et ouverte, mais sans doute trop réservée. Dans le fond, il est dommage que tu ne veuilles pas t’engager avec elle car elle présente, me semble-t-il, beaucoup d’affinités avec toi.
Julie avait deviné, sans même qu’il lui en parle, le sentiment de Moreau pour l’étudiante. Il demanda un surcroît de précisions.
- Lorsque tu pratiques la voyance, y a-t-il des cas où les caractéristiques du sujet apparaissent, je dirais, d’une manière évidente et sans effort, et d’autres où tout est flou et difficile à décrire ? Qu’en est-il pour Lynda ?
- Effectivement, quelquefois je ne vois rien, c’est le noir absolu, même si la personne est en face de moi. Cela m’arrive rarement mais... ce fut, malheureusement, ce qui se produisit pour Laurent quand je fis sa connaissance. Je ne le “sentais” pas ! Pour ce qui concerne ton amie, la photographie et le dessous m’en donnent une idée déjà précise. Mais le mieux serait que je la rencontre.
Moreau réfléchit un instant.
- Si tu le désires, puisque je dois aller la chercher à midi au campus, je peux te la présenter au retour.
- Pourquoi ne pas venir tous deux déjeuner ici ? proposa Julie.
- C’est entendu. Et quand, après le repas, Lynda et moi serons rentrés à Bellevue, passe-moi un coup de fil pour me faire connaître ton jugement.
Il sortit en remerciant la jeune femme.
o-o-o-o-o
Lynda attendait depuis quelques minutes sur l’esplanade centrale. La séance de travaux dirigés s’était terminée un peu en avance, et la jeune fille était heureuse de se réchauffer aux rayons du soleil, après cette matinée passée dans des salles plutôt froides. Mais son bonheur n’avait pas qu’une composante physique. Elle se savait attendue et n’en doutait pas une seconde. Elle ne se trompait pas car, à midi juste, la belle CX grise aux reflets métallisés s’immobilisait à sa hauteur. Elle n’osa pas embrasser son amoureux, bien que l’envie ne lui manquât pas, à cause de la présence à proximité de plusieurs étudiants faisant de l’auto-stop.
- Mon amour, tu dormais comme un gros bébé, ce matin, fit-elle, enjouée, alors qu’ils abordaient la route d’Aïn El Bey.
Il ne pouvait lui avouer la raison de ce sommeil tardif.
- Sais-tu que nous sommes invités à déjeuner chez les Gaillet, des amis coopérants, dont j’ai dû déjà te parler.
- J’aimerais tellement être seule avec toi, mon chéri !
Il se dit qu’il était grand temps de mettre en action le plan de rupture imaginé chez Julie, car Lynda commençait à employer un langage qui ne trompait guère sur ses sentiments à son égard. Mais il ne le ferait qu’après le repas. Elle continua :
- As-tu trouvé ma photo, sur la table, avec le mot d’explication ?
- Oui, bien sûr. A propos, Lynda, n’aurais-tu rien oublié chez moi ce matin ?
- Je vois... fit-elle d’une délicieuse voix chantonnante... mais ce n’est pas un oubli. J’ai pensé qu’il était resté dans la chambre et je ne voulais pas te réveiller pour si peu.
- Si peu ? N’est-ce pas pourtant essentiel pour une femme ?
- Non, pas vraiment. Regarde, chéri, je suis allée en cours telle que je suis sortie de chez toi. Comment me trouves-tu ? Et elle redressa fièrement le buste tout en tirant le pull pour qu’il moule encore mieux sa poitrine vivante. Il ne put que la complimenter.
o-o-o-o-o
Julie avait préparé, dans le peu de temps dont elle avait disposé, un de ces repas simples et légers que Moreau affectionnait. Gaillet n’avait pas reparu depuis le matin et, sans doute, était-il chez sa maîtresse. C’est pourquoi Julie avait été heureuse d’inviter Yvan et Lynda car il lui était toujours pénible de se mettre à table seule.
L’atmosphère était détendue. Lynda parlait de sa vie d’étudiante. Elle fit la critique des enseignants, coopérants ou algériens :
- Il y a d’abord le problème de la langue. Il se pose essentiellement avec les coopérants bulgares, roumains, tchèques et russes. A certains cours, on ne comprend pratiquement rien parce que le professeur ne maîtrise pas le français. A la sortie de la toute première séance de physique, une de mes copines, placée dans les derniers rangs de l’amphithéâtre, était désespérée : elle disait que c’était impossible de continuer ainsi et qu’elle allait changer de filière, parce que les cours se déroulaient... en anglais ! Elle avait réellement cru, pendant deux heures de suite, que l’enseignant parlait la langue de Shakespeare ! En général, la situation s’améliore progressivement du fait que les auditeurs s’habituent à l’accent et aux tournures de phrase des étrangers, et que ceux-ci s’inscrivent aux leçons de français du centre culturel. Le second problème réside dans les différences de pédagogie, selon l’origine des enseignants. Les meilleurs sont, sans conteste, et sauf rare exception, les Français, à la fois sérieux, rigoureux dans leurs méthodes de travail et ne refusant jamais une explication sur un point difficile. Parmi les Algériens, on trouve aussi de bons pédagogues, à côté d’autres qui le sont moins. Mais leur défaut principal est, sans doute, le manque de rigueur se manifestant par une ponctualité peu évidente, des cours annulés sans prévenir, ou des textes d’examens bâclés. Quant aux gens des pays socialistes, ils appliquent des méthodes propres à eux. Certains lisent leur cours sans rien expliquer, d’autres donnent des exercices tellement simplistes, du genre application numérique, qu’ils ne présentent aucun intérêt didactique. Et la plupart s’arrangent pour que les notes des contrôles de connaissance ne soient jamais inférieures à quatorze ou quinze sur vingt ! Ainsi tous les étudiants sont reçus sans effort, et l’enseignant n’a aucune contestation à affronter. Les coopérants français ont, en revanche, la réputation de noter d’une manière plutôt sévère.
- Cela provient du système universitaire qui, chez nous, est très sélectif et d’un niveau général parmi les meilleurs, précisa Moreau.
- Justement, reprit Lynda, je voudrais parler d’un troisième problème. Il s’agit de celui du niveau des enseignants. Ce que tu dis, Yvan, est vrai car tous les étudiants remarquent la qualité des Français au point de vue des compétences. Même un assistant est capable de répondre à nos questions théoriques ou pratiques. A l’opposé, certains professeurs des pays socialistes, malgré la longueur de leurs titres et diplômes dont ils font, par ailleurs, étalage à la moindre occasion, cherchent visiblement à éviter la curiosité des étudiants. Dernièrement, le chargé de cours de biologie, un Russe, a répondu à une demande d’explication : “Vous n’avez pas à interrompre mon exposé, je ne suis pas un assistant, je suis un maître de conférences” ! Et l’autre jour, en travaux pratiques de chimie organique, l’assistant français a été obligé de contredire, devant nous, sa collègue roumaine qui nous avait induits en erreur ! Evidemment, certains étudiants préfèrent finalement les enseignants des pays d’Europe de l’Est parce qu’avec ces derniers, les diplômes sont plus faciles à obtenir. Mais tous ceux qui ont envie d’apprendre sérieusement choisissent, quand cela est possible, des modules encadrés par des Français.
Julie demanda alors s’il y avait beaucoup de coopérants techniques à la SONATREL.
- Il y en a quelques-uns, répondit Moreau, mais je les vois très peu. Nous travaillons dans des équipes spécialisées chacune dans un domaine particulier. J’ai déjà eu affaire avec un ingénieur italien et des techniciens russes, mais je ne peux guère les juger. Toutefois, il me semble que les employés algériens préfèrent obéir à des Français plutôt qu’à d’autres étrangers. On dirait que, d’une manière presque automatique, il s’instaure entre eux et nous une sorte de complicité et de communauté dont il faudrait certainement chercher les origines dans l’histoire et la mentalité des deux peuples. En toute chose, le Français bénéficie ici d’un a priori favorable, et je trouve cela tout à fait remarquable si l’on considère les événements tragiques d’un passé relativement proche.
Extrait du chapitre 7 du livre "Qacentina - Chronique constantinoise"
- Voilà bien ce que j’attendais ! fit le darki en passant la paire de jumelles à son collègue. On peut parier que ce type va prévenir les fuyards.
Dissimulés par une crête dominant, à bonne distance, le site du hameau, les deux gendarmes virent Nouar s’engager, à grandes enjambées, dans le canyon.
- Voici mon plan : je vais suivre cet homme jusqu’à son but, en restant hors de sa vue. Je me cacherai pendant qu’il discutera avec les autres et, lorsqu’il sera reparti, je tenterai de connaître leurs intentions. Ils vont probablement s’enfuir et peut-être pourrai-je ainsi les surprendre et les neutraliser. De ton côté, tu vas contacter par radio la brigade de Biskra. En cas de difficulté, tu chercheras un endroit suffisamment élevé pour améliorer la liaison. Si l’émetteur-récepteur ne fonctionne vraiment pas, rejoins Biskra avec la Land et reviens avec de l’aide.
Pendant que la camionnette s’éloignait, le darki resté seul se mit à dévaler le flanc de la butte opposé à la direction du village, de manière à ce qu’en décrivant une large courbe, il puisse pénétrer dans les gorges sans se faire repérer. Quand il se présenta devant l’étroit passage dans lequel Nouar avait disparu, il estima son retard à une vingtaine de minutes. Ce délai lui permettait de ne pas éveiller l’attention de l’homme. Bien que celui-ci restât invisible, grâce à sa confortable avance, le darki ne s’en inquiétait pas. Il était exclu que le marcheur puisse tracer son itinéraire ailleurs que dans le fond du canyon.
Une heure plus tard, Nouar toucha au but. Au pied des éboulis, il siffla à deux reprises entre ses doigts. Aussitôt, trois têtes enturbannées se penchèrent au-dessus du vide; et l’extrémité de la corde vint fouetter le monticule de rochers. L’homme de liaison s’y attacha solidement et se fit hisser jusqu’à la grotte.
Répercutés par les parois rocheuses, les sifflements avaient fait comprendre au darki, encore à cinq cents mètres en aval, que le repaire était proche. Avec d’infinies précautions, il continua sa progression, en scrutant attentivement le lit sableux de l’oued, les bouquets de palmiers s’échelonnant sur les berges, et les falaises verticales dominant le site. Sachant avoir affaire à des hommes a priori dangereux car armés, il avait sorti le Beretta de son étui. Il déboucha peu après dans la minuscule oasis créée par le méandre du cours d’eau, et estima, d’après la durée de son approche depuis l’instant des sifflements, que les déserteurs avaient trouvé refuge quelque part dans ce cirque ovale.
Si Omar, rapidement mis au courant de la situation, n’avait pas hésité longtemps. Il fallait quitter la grotte avant l’arrivée du détachement du darak el watani qui serait envoyé à leurs trousses. Mais où se retrancher ?
- Nous pourrions rejoindre Rhoufi, suggéra l’un des conscrits en cavale. Là-bas j’ai de la famille qui, je pense, nous hébergera.
- Ou même pousser jusqu’aux environs de Menaa, à travers le djebel El Azreg, dont les forêts, que je connais bien, nous protégeraient de nos poursuivants, renchérit l’autre.
- Pas question ! trancha leur chef, ce serait se jeter dans la gueule du loup. Pensez que si les darkis nous cherchent ici, ils visitent également les douars de vos familles. Ils nous piégeraient encore plus facilement que dans ces gorges.
Il réfléchit, tout en avalant à grosses bouchées, une des galettes que Nouar avait apportées.
- Il faut descendre à Biskra, exposa-t-il à ses compagnons. La petite mosquée de la palmeraie nous servira de cachette et bien malin qui nous imaginera en un tel endroit ! Les frères biskris se chargeront du ravitaillement.
- Oui, mais comment s’y rendre ? Il y a au moins quarante kilomètres !
- Nous allons revenir à M’Chounèche par le chemin des gorges et là-bas, nous emprunterons la voiture d’un de mes oncles. J’espère qu’elle fonctionne encore car c’est la seule du douar.
Et, se tournant vers l’entrée de la grotte, où s’était posté Nouar, il questionna :
- La vieille 403 de Rachid est-elle...
Il n’acheva pas sa phrase car, à cet instant précis, l’homme de garde se rejeta brusquement en arrière. Il regarda les trois autres et son visage blêmit.
- Il... il y a quelqu’un, balbutia-t-il en tendant le bras vers l’extérieur. J’ai vu une ombre derrière le tronc d’un palmier !
Si Omar plaisanta :
- C’est peut-être un touriste aventureux ou même une chèvre ! Mais je vais vérifier. Il ôta son turban trop visible et se mit à ramper vers la sortie. Parvenu au bord de l’abîme, il risqua un regard plongeant sur les alentours. Apparemment, rien ne bougeait sous les arbres. Mais soudain, la vue perçante de l’Aurèsien surprit le déplacement furtif d’un homme en tenue verte utilisant les troncs de palmiers comme écrans successifs. Pas de doute ! Le darak el watani avait déjà retrouvé leurs traces. Si Omar rampa à reculons vers l’intérieur du réduit et confirma la présence ennemie. Les deux autres déserteurs n’en menaient pas large et parlaient de se rendre. Leur chef dut les tancer, à voix basse, et leur assurer que rien n’était perdu.
- Il m’étonnerait fort qu’un détachement complet ait pu se mettre en chasse aussi promptement. D’ailleurs ils nous auraient déjà assiégés et attaqués. Le darki qui nous surveille sous les palmiers doit être seul, en reconnaissance.
Il saisit un des pistolets automatiques volés à Batna, en vérifia le chargeur, et se glissa à nouveau, à plat ventre, vers la sortie inondée de soleil. Il ne vit d’abord rien qui bougeât car l’uniforme vert du darki constituait un excellent camouflage sous les palmes de même couleur. Cependant, le gendarme se trahit par un léger mouvement involontaire. Le coup de feu éclata... dont les falaises se renvoyèrent l’écho durant plusieurs secondes. Le policier se plia en deux de douleur. L’unique balle tirée par le rebelle venait de lui traverser le pied. D’une rapide roulade latérale, il gagna un endroit plus sûr, derrière un tronc suffisamment large pour le dissimuler complètement. Mieux vaut attendre les renforts, se dit-il, l’ennemi semble redoutable !
Toujours coincés dans la grotte, les hors-la-loi hésitaient. Le darki était-il seul ? Avait-il été sérieusement touché, ou même tué ? Si Omar savait qu’il avait fait mouche mais sans plus. Le temps pressait, il fallait se décider.
- Ne moisissons pas ici, mes frères. Je me risque à descendre le premier. Vous me couvrirez puis vous me rejoindrez le plus vite possible pendant que je m’occuperai du darki, s’il se manifeste. Il devrait se tenir tranquille s’il est isolé.
Grâce à la corde fixée à un éperon rocheux, la plongée en rappel ne dura que quelques secondes. Le deuxième déserteur commença la manoeuvre pendant que le chef se dirigeait silencieusement vers les palmiers. Soudain, les deux adversaires se virent face à face, et deux coups de feu quasi simultanés éclatèrent. Le malheureux policier, déjà allongé à terre, se recroquevilla sur lui-même, mortellement atteint. L’agresseur, quant à lui, vacilla sans tomber, une balle fichée dans l’épaule. Les déserteurs, puis Nouar, avaient atterri au pied de la falaise et s’étaient jetés dans les rochers, croyant leur dernière heure venue. Mais Si Omar s’avança, grimaçant de la douleur lui étreignant l’épaule, qu’il comprimait de son bras valide.
- Il est mort. Maintenant, c’est du sérieux ! Il faut absolument nous tirer de cette souricière. Inch Allah !.
Le meurtrier avait compris la gravité de son geste. Il n’en fut que plus décidé à rejoindre Biskra, d’autant qu’il portait une vilaine blessure. Avant de se mettre en chemin, il se fit placer un pansement de fortune constitué de lambeaux découpés dans une peau de chèvre afin d’enrayer l’hémorragie.
L’arrivée à M’Chounèche fut moins glorieuse que celle du premier jour. Les trois hommes se savaient traqués, et leur fuite vers Biskra était urgente. L’oncle Rachid s’offrit immédiatement pour les conduire vers le sud dans son antique et toujours vaillante Peugeot. Sans perdre une seconde, les quatre hommes quittèrent le douar. Les gendarmes pouvaient surgir d’un instant à l’autre. La piste franchissait l’oued, gravissait les collines du versant opposé puis, à travers un plateau aride de cinq kilomètres environ, faisait sa jonction avec la nationale Constantine-Batna-Biskra, la route du Sahara. La vieille 403 peina dans les raidillons rocailleux, le moteur à la limite de sa puissance. Les amortisseurs ayant rendu l’âme depuis des lustres, la carrosserie se déhanchait au passage de la moindre bosse, arrachant des gémissements au blessé qui, de sa main libre, se cramponnait à la portière. La traversée du plateau, plus aisée, allait s’achever, et les fugitifs apercevaient le ruban d’asphalte de la nationale, lorsque la voiture s’affaissa d’un seul coup avec un craquement métallique. Les passagers descendirent et constatèrent que le pont arrière avait cassé net. Bien que diminué physiquement par sa blessure, Si Omar gardait son esprit de décision intact.
- Gagnons la route à pied et là-bas, arrêtons une auto en obligeant son conducteur à nous emmener à Biskra.
Laissant Rachid perplexe devant son épave, les déserteurs se dépêchèrent de parcourir les quelques centaines de mètres les séparant du goudron. Avec leurs djellabas marron foncé et leurs turbans jaunes et blancs, ils avaient l’apparence d’innocents bergers des Aurès, mais sous les amples vêtements pendaient armes et munitions. La route était déserte lorsqu’ils y parvinrent. Pas de darkis en vue. La chance leur souriait encore. Il fallut attendre un bon quart d’heure avant qu’un ronflement lointain annonçât l’approche d’un véhicule.
o-o-o-o-o